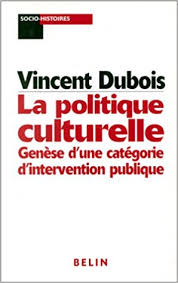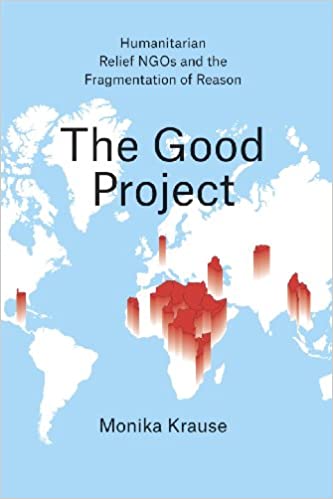Promis par Emmanuel Macron durant sa campagne présidentielle, le “Pass Culture” est une aide d’un montant de 500 euros qui sera délivrée aux jeunes Français âgés de 18 ans. La ministre de la Culture et architecte de ce projet, Françoise Nyssen, a annoncé le 17 décembre 2017 qu’il serait testé dès septembre 2018 dans 4 départements. Il a pour but de permettre aux nouvelles générations d’accéder à la culture, quels que soient leurs origines sociales, leurs revenus ou leurs lieux de résidence. Cette aide doit ainsi aider à lutter contre la ségrégation culturelle, qui a fait de la culture un produit de luxe. Elle veut aussi combattre les “déserts de culture” observés dans les quartiers les plus défavorisés des grandes métropoles ou les zones rurales. L’ouvrage de Vincent Dubois, sociologue et politiste, issu en 1994 de sa thèse, permet de comprendre la genèse de « la formation de la culture comme catégorie d’intervention publique en France » (p. 8). Il s’agit d’expliquer la manière dont la culture est construite comme objet de politiques publiques, mais aussi les conditions historiques particulières qui ont rendues possible l’élaboration de la politique culturelle comme catégorie légitime d’action publique.
La culture ne forme pas un secteur clairement défini de l’action publique mais plutôt un ensemble flou et incertain selon Vincent Dubois. Dans l’introduction, la politique culturelle est liée au travail de classement et de mise en forme dont l’action publique est le produit et qu’elle produit en retour. Elle classe et met en forme certains domaines faisant partie de la catégorie “culture”. Le point commun entre les domaines qu’elle touche, c’est la qualification “culturelle” et la recherche d’une intégration commune par les pouvoirs publics, ou la “démocratisation de la culture”.
Le livre vise donc à donner une reconstitution de la formation de la culture comme catégorie d’intervention publique en France. Le principal problème de la politique culturelle se trouve dans la difficulté à trouver une définition de celle-ci, même dans les discours et les textes officiels. Cela se confirme par le changement fréquent des attributions du ministère de la Culture (P9 et 10/exemples). Pour Pierre-Michel Menger, sociologue français et spécialiste des mondes de l’art et de la création, la politique culturelle se caractérise par “la multiplication des activités, des domaines et des modes d’intervention, l’hétérogénéité des actions additionnées, l’indifférence, l’impuissance ou l’hostilité à l’égard de toute forme de rationalisation du gouvernement des hommes et des choses de la culture, qui supposerait la promulgation de finalités précises et concrètes, la hiérarchisation des priorités, la gestion rigoureuse des ressources et l’évaluation méthodique des résultats”. (P9)
Une catégorie improbable. Culture et politique avant la “politique culturelle”
Vincent Dubois montre dans ce chapitre comment, à partir de 1890, il y a une séparation entre l’Art et l’État, ou plutôt, au commencement, un rejet de L’État par les artistes. La première sous-partie qu’il intitule « L’art et l’État : la construction d’un antagonisme » montre de quelle façon la séparation des Beaux-Arts et de l’État est faite. A l’époque, il était même mal vu d’être proche de quelque institution étatique que ce soit pour un artiste. Le refus de L’État par les artistes à l’époque était aussi le moyen de parler de politique par le biais de l’art : « Parler de l’art et de l’État, c’est en effet aussi parler de l’État, et transposer dans la politique des valeurs comme la liberté et le progrès telles qu’elles sont définies au sein du champ artistique. » (p. 25) Les artistes vont tenter de délégitimer les principaux acteurs de l’intervention artistique publique (l’administration des Beaux-Arts et ses agents, les parlementaires et leurs débats, les postes ministériels et leurs titulaires). De plus, « accusés de ne pas s’intéresser à l’art, fonctionnaires, parlementaires et ministres sont accusés quand ils s’y intéressent de le faire pour de mauvaises raisons » ou « à des fins tactiques » (pp. 36-37).
La seconde sous-partie du chapitre s’intitule « L’art et le peuple : l’invention d’une contre-politique ». Elle montre la raison pour laquelle les artistes étaient contre l’alliance de la culture et de l’État. « Pour le salut de l’art, il faut l’arracher aux privilèges absurdes qui l’étouffent, et lui ouvrir les portes de la vie. Il faut que tous les hommes y soient admis. Il faut enfin donner une voix aux peuples, et fonder le théâtre de tous. Il ne s’agit pas d’élever la tribune d’une classe : le prolétariat, ou l’élite intellectuelle ; nous ne voulons être les instruments d’aucune caste : religieuse, politique, morale ou sociale ; nous ne voulons rien supprimer du passé ou de l’avenir » (p. 44). Par cette citation, nous voyons que les artistes souhaitaient être la voix peuple. Mais l’auteur note qu’une telle revendication n’est pas sans lien avec les stratégies de reconnaissance à l’œuvre dans le champ artistique : « La défense du théâtre populaire apparaît ainsi pour partie comme la traduction en engagement intellectuel d’une stratégie contrariée d’entrée dans le champ littéraire, recherchant ailleurs – dans le “peuple” – une légitimité difficile à y obtenir. » (p.46)
Ainsi, dans le premier chapitre, l’auteur explique dans quelle mesure il était impossible d’allier Culture et État à l’époque, notamment car les artistes eux-mêmes refusaient toute idée d’institution. Ici apparaît l’impossibilité de la formalisation d’une politique culturelle à part entière car la construction d’un antagonisme radical et l’intériorisation de l’illégitimité rendent impossible l’établissement d’un cadre favorable à cette fin. La culture ne rentre pas dans le cadre des politiques publiques. Les tentatives d’institutionnalisation d’une politique artistique dans les années 1870 – 1890 échouent (échec du ministère d’Antonin Proust sous la législature de Gambetta) ; ces échecs montrent le flou de ces politiques dans les structures mêmes chargées de les promouvoir. « Sans ministère, les Beaux-Arts forment une catégorie éclatée et incertaine de l’intervention gouvernementale » (p. 86), l’administration des Beaux-Arts prend la forme d’une Direction générale, d’un Secrétariat général, d’un sous-secrétariat d’État et non d’une institution organisée et réelle.
Les conditions favorables à la mise en forme d’une politique ne vont pas se créer avant un moment. La première moitié du XXème siècle, en termes de politique culturelle, sera marquée par des mouvements culturels et des mobilisations pour la culture du peuple. C’est à partir de là que le mot “culture” est plus utilisé. Toutefois, il continue de susciter l’embarras et ceux qui l’emploient s’excusent de l’avoir utilisé : on remarque alors qu’il pose encore problème de par le fait qu’il sous-entend institution. On assiste à des mobilisations pour la culture du peuple. Elles tendent à faire de la culture le « champ de bataille » des classes en lutte et s’inscrivent dans la concurrence entre les agents prétendant représenter le peuple. Encore une fois, ici la culture est utilisée à des fins politiques.
Sinon, des mobilisations à visée réformistes aussi font surface. La conjoncture particulière du Front populaire a permis le dépassement de certaines controverses. Mais cette convergence n’a pas permis la mise en place d’une politique culturelle réglementée et institutionnelle avec un budget alloué. Jacques Soustelle, proche du PCF a dit : « Parallèlement au grand mouvement politique et social du Front populaire […] se déroule dans notre pays un vaste mouvement culturel ? Sa devise pourrait être : ouvrons les portes de la culture. Brisons la muraille qui entourait comme un beau parc, interdit aux pauvres gens, une culture réservée à une “élite” de privilégiés ». (p. 116). Vincent Dubois évoque dans cette partie les échecs d’institutionnalisation de la politique culturelle. « Comme dans la période précédente, les éléments qui permettraient l’objectivation d’une politique dans le domaine culturel – un ministère, des institutions et structures administratives stables – font défaut jusqu’à la création du ministère des Affaires culturelles, en 1959. » (p. 134)
Un grand retournement (génèse et ambiguïtés de la politique culturelle)
La deuxième grande partie de cet ouvrage concerne « le grand retournement » comme le qualifie l’intellectuel hongrois Karl Polanyi qui déclare que « les problèmes culturels, historiquement construits contre l’État, deviennent des problèmes D’État ». En effet l’instauration de la Vème République marque le début d’une véritable politique culturelle étatique, dotée d’un ministère spécifique. Cette création ne découle en rien d’un projet préétabli, mais plutôt d’un coup politique « bricolée » à l’initiative de Georges Pompidou, alors directeur de cabinet de De Gaulle. Ce ministère est en effet « taillé » pour André Malraux, son statut d’écrivain célèbre permettant en effet de couper court à toute accusation d’incompétence dont faisait systématiquement l’objet ses prédécesseurs. Selon lui « l’État n’est pas fait pour diriger l’art mais pour le servir » (p.219). Mais après le détachement en 1960 de la tutelle de l’Education nationale, le budget des Affaires Culturelles est d’environ 0,4 % du budget total de l’État, soit le plus faible.
Malraux va alors militer pour l’établissement d’un budget et d’un personnel propres à son ministère des Affaires Culturelles afin de l’établir comme une véritable fonction gouvernementale, l’autonomie budgétaire permettant l’autonomie d’action. Il est considéré à l’époque comme un personnage très important de ce gouvernement, « André Malraux est l’esprit, de Gaulle la puissance : l’alliance de la plume et du bouclier ». Cependant certains auteurs comme Roland Desné mettent en garde l’opinion en disant que « le statut d’écrivain de Malraux ne doit pas rendre aveugle à la faiblesse de la réalisation effective du ministre » (p.259). Contre toute attente, le ministère des Affaires Culturelles perdure après le départ de Malraux, bien que faiblement investi par les fonctionnaires du ministère de l’Éducation Nationale et peu attractif pour les jeunes énarques.
C’est surtout à partir du début des années 1970 que l’administration culturelle devient un terrain d’investissement pour des fonctionnaires. Cela résulte d’une certaine stabilité acquise, ses 10 ans d’existence faisant qu’elle n’est plus considérée comme vouée à une disparition rapide. Le ministère des Affaires Culturelles s’installe alors progressivement sur le plan administratif, et devient beaucoup plus attractif pour les énarques et les hauts fonctionnaires. Les responsables politiques vont développer l’idée de la planification culturelle, un processus visant à exploiter les ressources culturelles d’une collectivité, et renforcer la gestion de ses ressources. L’essor des politiques culturelles municipales va alors se matérialiser par la création de nombreux équipements sociaux, sportifs et culturels, afin de « protéger la santé physique et l’équilibre psychologique de la population » des dangers de la « civilisation industrielle » .
Les sciences sociales vont être intégrées à l’élaboration de la politique culturelle, lui attribuant une légitimation démocratique. Cependant elles ne jouent qu’un maigre rôle d’aide à la décision et sont trop peu exploitées. Des sondages concrets, comme par exemple l’évaluation du nombre de français étant déjà allé au théâtre, permettaient de fixer des objectifs clairs à atteindre. La politique culturelle a pour objectifs de rendre accessible à tous l’héritage culturelle pour le transmettre, mais aussi de stimuler la création artistique en améliorant ses conditions comme l’éducation, l’enseignement artistique, ou encore la situation économique, juridique et sociale du créateur.
Institutionnalisation et professionnalisation d’une nébuleuse de l’action culturelle de plus en plus large
Dans la dernière partie de l’ouvrage la période étudiée est vu comme la dernière phase de l’institutionnalisation de la politique culturelle, notamment Jack Lang qui, en 1981, est nommé ministre de la culture et on remarque que dans les années qui suivent que le budget alloué à la culture augmente de 74%. Grâce à cela, la culture s’enracine un peu plus dans le champ institutionnel et politique, de plus les médias traite la culture plus largement. L’auteur insistera de nouveau sur une importante évolution politique et il s’appuiera sur l’analyse de la structure sociale des supporters de la nouvelle majorité. On découvre que parmi les soutiens de François Mitterrand se trouvent des intellectuels ainsi que des artistes. Pour le PS, les adhérents appartiennent principalement à la classe moyenne à fort capital culturel.
Deux phénomènes se rejouent dans cette période. Tout d’abord, le resserrement de l’espace des agents producteurs de cette politique avec l’apparition de diplômes spécifiques et le maniement d’une rhétorique professionnelle. Ensuite, il y a l’éclatement de son objet ; après la démocratisation culturelle s’en suit la phase de « démocratie culturelle ». La politique culturelle s’ouvre à d’autre genre comme la BD, le cirque, le rock… Ainsi ces deux phénomènes poussent la culture à s’élargir et se relier à des domaines éloignés comme la cuisine, le tourisme…Vincent Dubois parle de « spirale inflationniste » du « jeu du catalogue ». On retrouve dans cette partie la thèse de principale de l’ouvrage : « c’est une catégorie floue qui est institutionnalisée et ce n’est que grâce au flou qu’elle est institutionnalisée » (p. 237).
Néanmoins, l’auteur relève un paradoxe, celui de la professionnalisation des politiques culturelles. Cette professionnalisation prend plusieurs formes. Certaines fonctions bénévoles deviennent rémunérées ; il y a l’apparition de nouvelles formations spécialisées dans la gestion de la culture et l’administration, l’organisation de colloques spécialisé. Mais l’auteur s’attache à une idée forte qui est que « cette professionnalisation revêt cependant des formes particulières qui ne correspondent que très partiellement aux critères habituellement retenus par la sociologie des professions. » (p. 240). Plusieurs causes en sont la raison comme par exemple le fait que cette professionnalisation s’appuie sur des nouveaux cadres généralistes qui affecte une « nébuleuse » d’agents et il se fonde sur des savoirs faire spécialisés. Alors cette combinaison permet de dire que ce processus tient tout autant de « l’effet rhétorique que de l’effet de croyance ». (p. 240).
Cette professionnalisation permet au monde de la fonction publique de voir apparaitre des chemins originaux. On peut rajouter le fait que ce processus va influencer le « style » des politiques tant nationales que locales. Cette certaine neutralité de la professionnalisation permet aux agents culturels de revendiquer une action apolitique. L’auteur parle de professionnalisation paradoxale car elle se trouve dans un contexte sociétal qui pousse le secteur culturel, d’une part à une forte rentabilité et d’autre part il est vu comme la nouvelle principale source d’emplois. A cela s’ajoute l’élaboration économique du questionnement culturel. Elle est dû aux hauts fonctionnaires de gauche qui dans les années 1980 essayent de réconcilier l’économie et la culture. Toutefois, l’auteur montre bien que cette professionnalisation mène à une pacification des rapports sociaux : « L’effet de cercle entraîné par cette professionnalisation particulière contribue ainsi à la formation d’un apparent consensus culturel tendant à occulter ce que ces formes culturelles pacifiées doivent aux luttes sociales qui ont permis leur imposition. » (p. 27)
Est-ce que la question de l’État contre la culture est toujours viable ? Avec l’élargissement des domaines couverts par l’intervention culturelle publique, les bordures de la culture sont devenues floues. Le fait que l’État cherche à légitimer de nouvelles formes d’expression qui auparavant n’était pas considéré dans la culture, pour l’auteur cela « conduit à réactiver les polémiques sur la définition de la culture, la légitimité des pouvoirs publics à la définir, et finalement, sur les fondements mêmes de la politique culturelle ». La politique menée par Jack Lang était présentée comme briseur des frontières culturelles passant par une grande ouverture artistique et patrimoniale. Ce changement de rhétorique s’inscrit aussi dans des institutions et des pratiques. Pour Vincent Dubois, cette politique est surtout symbolique puisqu’elle porte sur des représentations : « Cette politique symbolique est explicitement censée permettre la remise en cause des hiérarchies culturelles considérées comme reflets des hiérarchies sociales au profit d’un relativisme d’institution permettant l’avènement d’une démocratie culturelle. […] l’intervention publique tend à prendre une part active aux processus de légitimation culturelle et à devenir l’un de ses vecteurs parmi les plus importants. » (p. 279). Même si cette politique cherche à valoriser des cultures régionales ou communautaires, on peut observer des limites comme l’échec de la conquête de nouveaux publics.
Les critiques qui sont faite portent généralement sur les limites et les remises en cause des redéfinitions étatiques de la culture. A la fin du chapitre on peut relever des critiques de la politiques culturelles faites par des intellectuels comme Alain Finkielkraut (La défaite de la pensée) ou encore Michel Schneider. Pour eux le relativisme culturel que met en avant l’Etat français n’est pas en adéquation avec leur définition de la culture et souhaite une définition plus universaliste comme à l’époque des Lumières. L’auteur conclut sur ces ouvrages en expliquant que : « …ces ouvrages et le battage auquel ils ont donné lieu en viennent à mettre en cause, au nom de la culture, la politique culturelle telle qu’elle a été institutionnalisée avec le ministère d’André Malraux, et plus encore telle qu’elle a été redéfinie dans les années 1980. Mais avec cette mise en cause, ils ne font en fin de compte qu’entretenir le statut sous lequel apparaît la politique culturelle dès sa première institutionnalisation : celui d’un objet polémique placé au centre de controverses générales sur l’état du monde social et ses rapports avec l’Etat. » (p 298)
Conclusion
Pour finir, on peut dire que cet ouvrage qui se place entre sociologie, l’histoire et sciences politiques s’intéresse à la genèse complexe de la catégorie de « politique culturelle ». En effet, ce n’est qu’à partir de 1960 qu’on observe l’émergence d’une culture comme catégorie d’Etat. Même si en 1980 cette catégorie se stabilise, s’institutionnalise des pratiques et des représentations de l’intervention publique, elle reste malgré tout incertaine et très souvent remise en cause. Néanmoins, ce flou qui caractérise son apparition ne suffit à définir ses limites. « A chaque étape de sa définition, la politique culturelle a de fait été établie au nom d’une idéologie du décloisonnement, qui prétend rompre avec toutes les frontières établies, qu’elles soient verticales – entre les groupes sociaux – ou horizontales – entre les secteurs. […] A cette idéologie du décloisonnement se combine une autre contradiction structurelle et structurante : l’affirmation du caractère anti institutionnel des institutions de la politique culturelle, et partant de cette politique elle-même. » (p 301). Toutefois, comme le rappelle l’auteur à la fin de son livre, il persiste un décalage entre les objectifs des politiques culturelles et leurs résultats. En effet, malgré un accroissement de l’offre culturelle, cela a peu participé à une réelle « démocratisation ». C’est sur un questionnement de la prise en compte des pratiques et l’évolution des pratiques de ceux à qui s’adresse la politique culturelle que se referme le livre de Vincent Dubois.
Simon Boyer, Théo Guerlet et Sarah Razafinramova