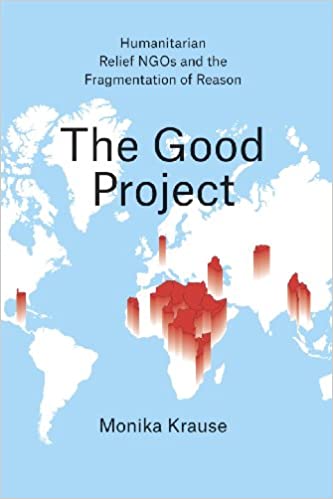Tabl-trai/Flickr, CC BY-SA
Fabrice Hamelin, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

Cet article est publié dans le cadre de la Fête de la Science 2017, qui se tient du 7 au 15 octobre, et dont The Conversation France est partenaire. Retrouvez tous les débats et les événements de votre région sur le site Fetedelascience.fr.
Les chassés-croisés sur les routes des vacances réactivent dans les médias comme dans l’opinion publique une attention particulière aux chiffres de la sécurité routière. Les uns après les autres, ils témoignent des mauvais résultats actuels de cette politique. En 2016, avec 3 477 tués sur les routes, la France a ainsi connu une troisième année consécutive d’augmentation. Au mois de juin dernier, on a enregistré une hausse de plus de 15 % des tués sur les routes par rapport à juin 2016. Au-delà des chiffres globaux, de nouvelles catégories de victimes se distinguent : les piétons et les cyclistes… Ce sont les usagers de la route les plus vulnérables. Ce sont aussi ceux qui incarnent la mobilité douce, celle qu’on aimerait voir se développer demain.
Bien entendu, ce bilan n’a plus rien à voir avec les 18 000 tués de 1972 ou même avec les 8 000 tués du début des années 2000. Mais la dynamique initiée en 2002, qui avait permis à la France de connaître douze années consécutives de baisse, apparaît bel et bien interrompue. De plus, l’insécurité routière demeure la huitième cause de mortalité en France, en terme de nombre de victimes, et la troisième en terme d’années de vie perdue.
La comparaison est donc sans appel avec la réussite d’une politique publique impulsée au plus haut niveau de l’État, au début des années 2000, et l’amélioration continue de ses résultats pendant plus de dix années. Quinze ans après le discours du Président Jacques Chirac, le 14 juillet 2002, nul ne peut plus douter que la politique publique de sécurité routière soit de nouveau en échec en France.
À chacun son explication
Les explications communément avancées sont sans surprise. Les autorités publiques incriminent le relâchement des comportements des conducteurs (excès de vitesse, abus d’alcool, usage du smartphone). Les associations de sécurité routière y voient le résultat d’un quinquennat marqué par le désintérêt des pouvoirs publics pour cette cause et l’absence d’innovation (notamment le refus de l’abaissement de 90 à 80 km/h sur les routes). Des associations d’automobilistes y lisent au contraire l’échec d’une politique uniquement répressive. Les experts nuancent en soulignant que les progrès ne peuvent plus, aujourd’hui, intervenir qu’à la marge et de manière ciblée.
Même l’annonce de la mobilisation massive des forces de l’ordre au bord des routes lors des grands chassés-croisés de la période estivale est vécue comme un retour des vieilles recettes, un signe supplémentaire du déboussolement de ceux qui pilotent, aujourd’hui, cette politique publique.
Nul doute que ces éléments sont à prendre en compte pour qui veut comprendre ces médiocres résultats. Mais ce sont d’autres changements qui sont évoqués ici. Ils sont bien plus conséquents et surtout compliquent l’action de ceux qui portent et mettent en œuvre la politique de sécurité routière.
Le retour de l’État central
Le tournant opéré en 2002 dans la politique nationale de sécurité routière s’est appuyé sur le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Il s’est caractérisé par le déploiement des radars automatiques au bord des routes françaises. L’impulsion donnée, au plus haut niveau de l’État, a pu alors rapprocher la lutte contre la violence routière de la lutte contre la délinquance ordinaire (aggravation des peines, rhétorique de la tolérance zéro, technologisation de la surveillance).

François Goglins/Wikimedia, CC BY-SA
Cela a donné du crédit à l’hypothèse du « tournant répressif » dans la politique de sécurité routière. Mais cela a aussi permis aux administrations de l’État de réaffirmer leur centralité dans l’action publique de sécurité routière, en réaction à vingt ans de décentralisation de cette politique qui n’avaient pas produit les résultats escomptés. Cette reprise en main par l’État central a également pu compter sur un système d’acteurs peu étendu, relativement unanimes et confortés par des résultats rapides et soutenus. Une décennie plus tard, ce système d’acteurs de la sécurité routière a laissé la place à un autre, nettement moins favorable au déploiement de l’action publique.
Le retour des controverses
Au tournant des années 2010, de nouveaux acteurs nourrissent un débat public qui porte moins sur les radars automatiques que sur son association au permis à points et ses conséquences supposées. La combinaison instrumentale perçue, jusque-là, comme vertueuse serait devenue « vicieuse ». Même si les travaux des experts dénoncent les mensonges que seraient l’explosion du nombre des permis annulés et le développement de la conduite sans permis, le débat se politise, s’installe au Parlement et aboutit à une réduction du temps de récupération des points perdus.
La controverse interroge aussi les effets des avertisseurs de radars. Ces débats ont pour autre conséquence de modifier la qualité et le nombre des acteurs mobilisés par les questions de sécurité routière. La structuration des fabricants d’avertisseurs, la réunion des associations d’automobilistes, la visibilité des avocats spécialisés dans la récupération des points et l’intervention de parlementaires forgent un système d’acteurs divisés et dont la diversité s’est grandement accrue.
Le panel des acteurs privés directement intéressés par la sécurité routière et plus largement par la conduite automobile s’étend. Ce ne sont plus simplement les acteurs en lien avec l’automobile qui sont concernés mais aussi ceux des télécommunications, du numérique et des services.
Le retournement de la promesse télématique
Des grandes entreprises comme Google, Tesla ou Uber sont en train de changer la mobilité. Pour la sécurité routière, de nouveaux outils et services sont développés, mis sur le marché ou portés par la société civile. Ils viennent contrarier l’efficacité des instruments déployés par les pouvoirs publics.
Parmi les nouvelles technologies embarquées, on trouve des appareils de détection mais aussi des applications collaboratives capables de contrarier le bon fonctionnement des outils de régulation des conduites automobiles. Dans un premier temps, ces outils ont pu contribuer à l’acceptation de la politique de sécurité routière. Mais, après les controverses des années 2010, ils font davantage figure d’outils de résistance, individuelle ou collective, au système de contrôle et de sanction automatisé des infractions à la vitesse autorisée.
Plus encore, ils apparaissent en capacité de rendre inopérante la politique gouvernementale, bien plus que ne le furent l’achat de points sur Internet ou même l’offre de services d’avocats spécialisés dans la détection des failles juridiques des dispositifs de sanctions.
La promesse des progrès technologiques
La politique de sécurité routière s’inscrit donc, aujourd’hui, dans un environnement routier en pleins bouleversements. Ceux-ci n’invalident cependant pas complètement « la promesse télématique » (pour reprendre l’expression du sociologue Pierre Lannoy). En effet, les pistes d’amélioration sont désormais envisagées à partir de ce qu’on appelle les solutions de « mobilité intelligente » : des modifications apportées au véhicule autant qu’aux infrastructures routières. Il s’agit, d’une part, du développement d’un véhicule rendu intelligent par l’incorporation d’outils d’assistance à la conduite ou, de manière plus radicale, par son automatisation. Et, d’autre part, des espoirs mis dans la route de cinquième génération.
Les promoteurs de l’un et de l’autre les présentent comme des leviers pour une amélioration profonde de la fluidité de la circulation et aussi de la sécurité des déplacements. Là encore, ce sont les progrès technologiques qui apparaissent les plus susceptibles de répondre demain à plus d’un siècle de préoccupations routières, et donc à celle que l’accidentologie peine de nouveau à résoudre.
Enfin, à la promesse technologique, il convient d’ajouter la remise en cause de l’usage de l’automobile. Cela peut passer par la valorisation de modes alternatifs (covoiturage, autopartage) de déplacement. Mais cela peut aussi aller jusqu’au retour de formes d’autophobie et à l’installation durable d’un désintérêt pour l’automobile, que l’on saisit aujourd’hui à travers des jeunes moins nombreux à passer leurs permis de conduire, des urbains moins enclins à acheter des automobiles et donc la promotion des autres formes de mobilité.
Vers la fin de la politique publique de sécurité routière ?
Ces différentes transformations, liées à la mobilisation des nouvelles technologies et à la transformation du système d’acteurs mobilisés par les problématiques de sécurité, font peser le risque d’une circulation routière qui cesserait d’être un objet de politiques publiques pour devenir le produit d’offres renouvelées du marché. Les acteurs privés, et notamment ceux du marché de l’information routière, se trouveraient alors en capacité de devenir les principaux acteurs de la conception et de la prise en charge du problème de la sécurité routière !
![]() On pourrait dès lors envisager un retour paradoxal à une forme de « laissez rouler » contre lequel s’est bâtie, au tournant des années 1960-1970, la politique française de sécurité routière ! C’est aussi pour ce risque-là qu’il convient de prendre au sérieux les mauvais résultats de la sécurité routière et d’être attentif aux réponses que les pouvoirs publics envisagent d’y apporter.
On pourrait dès lors envisager un retour paradoxal à une forme de « laissez rouler » contre lequel s’est bâtie, au tournant des années 1960-1970, la politique française de sécurité routière ! C’est aussi pour ce risque-là qu’il convient de prendre au sérieux les mauvais résultats de la sécurité routière et d’être attentif aux réponses que les pouvoirs publics envisagent d’y apporter.
Fabrice Hamelin, Enseignant-Chercheur en science politique, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.