Et si, sous les traits de mesures sécuritaires destinées à protéger les citoyens d’une menace plus ou moins imminente, se cachait en réalité une entrave à nos libertés les plus fondamentales, dont l’objectif serait de contrôler la plèbe ? Tel est le postulat de la généalogie des dispositifs de surveillance entreprise par Armand Matellart, écrivain et sociologue franco-belge.
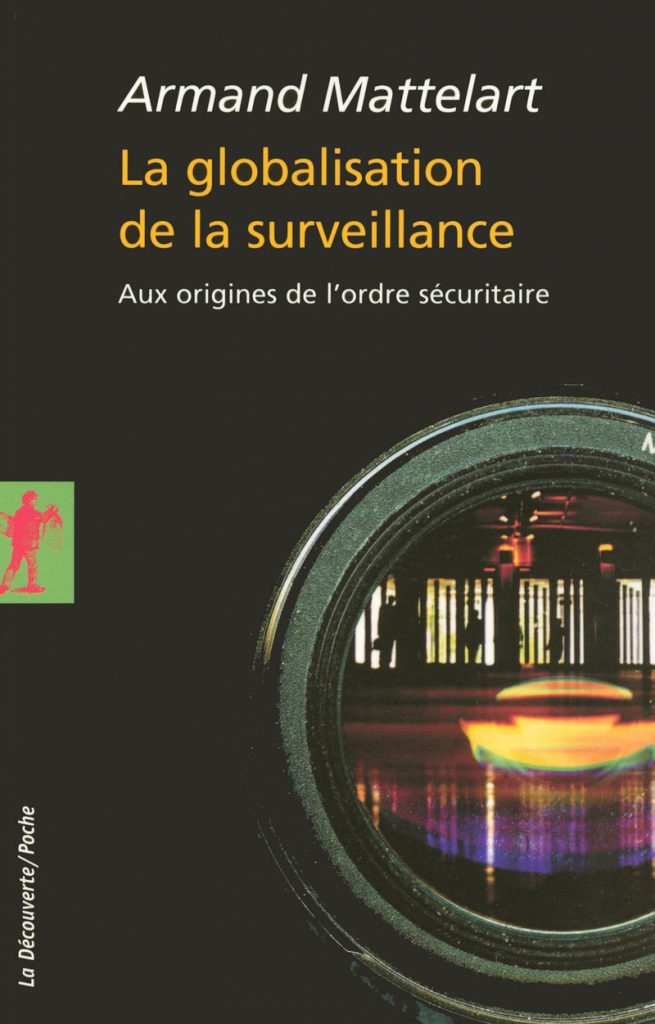
Dans son ouvrage, l’auteur met en évidence la porosité de la frontière qui sépare les mécanismes étatiques garants de l’ordre social, et ceux voués à soumettre le peuple au pouvoir établi. A travers une démarche socio-historique, Mattelart dénonce la prolifération des méthodes de surveillance et leur perfectionnement au fil du temps, qui connaîtront un rebond sans précédent avec les attaques du 11 septembre 2001. Polymorphe, ce système de contrôle des individus peut agir sur leur corps, sur leur esprit, dans les limites du territoire national mais aussi et surtout à l’échelle mondiale. A l’aune de la mondialisation, les États et les entreprises privées ont en effet mis en commun leurs compétences et leurs technologies au service d’une surveillance généralisée. Divisé en 3 parties, « Discipliner/gérer », « Hégémoniser/pacifier » et, « Sécuriser/insécuriser », tout l’enjeu de cet ouvrage est de faire prendre conscience du danger que représentent ces dispositifs et interrogent le socle sur lequel repose nos sociétés : sommes-nous toujours en démocratie ?
Le contrôle des corps : quand la science est mise au service de la surveillance
L’utilisation des termes « discipliner » et « gérer » en tête d’ouvrage n’est pas anodine : le premier désigne le fait de « soumettre quelqu’un, un groupe à l’obéissance, à un ensemble de règles qui garantissent l’ordre dans la collectivité où il se trouve » ; le second signifie « administrer, assurer la gestion » [i]. Armand Mattelart définit par là le rôle initial de l’État, chargé d’organiser la société dans l’intérêt général, le peuple accepte alors de s’y soumettre car il l’a choisi librement. C’est au nom de ce principe que l’État va justifier la surveillance et le contrôle de ses citoyens. Pourtant, l’Histoire a prouvé à maintes reprises qu’une trop grande immixtion du pouvoir politique dans la vie du peuple conduisait à des dérives, dont l’émergence de régimes totalitaires au XXème siècle constitue le parfait exemple. Dès le XVIIIème siècle, le philosophe Jeremy Bentham voyait dans la surveillance un « pouvoir de l’esprit sur l’esprit, en quantité jusque-là sans exemple ». Sa réflexion va le pousser à ériger un véritable modèle de société, basé sur le concept de panoptique qu’il développe en 1791. L’idée est simple : une tour dans laquelle se trouve un surveillant est construite depuis un point central, entourée par un bâtiment divisé en alvéoles où les surveillés ne peuvent déceler celui qui les observe.
Cette organisation spatiale, destinée au départ au milieu carcéral, doit s’étendre progressivement à l’ensemble de la société (écoles, hôpitaux, casernes…) afin de réduire les dépenses de l’État, améliorer l’efficacité des services et limiter les accidents. A travers cette « utopie », Bentham est l’initiateur de l’utilitarisme, cette école de pensée qui prône la maximisation du bien-être collectif par la raison, au détriment des qualités morales de l’agent. Seules les conséquences de l’acte permettent en effet de juger de sa moralité, peu importe les motifs invoqués par l’agent.
Ce rationalisme va alors profondément modifier la structure de la société en guidant les politiques entreprises par l’État. Progressivement, c’est l’entrée dans une nouvelle ère de l’action publique qui se dessine et, qui sera mise en lumière par le philosophe Michel Foucault. Pour ce dernier, le panoptique constitue le paradigme de la « société disciplinaire » : là où la société antérieure, dite de souveraineté, s’exerçait dans les limites d’un territoire sur des sujets, cette nouvelle société s’attache plutôt aux individus, aux corps, aux esprits. Son unique but est de contrôler la population qui serait régie par des lois biologiques, ce qui correspond à la notion de biopolitique inventée par Foucault. Celle-ci se traduit par la prise en considération de ces lois et l’usage de statistiques, de données, pour mettre en place des politiques de santé publique efficaces sur le long terme. L’enjeu n’est plus tant de contrôler la population par la crainte de la sanction juridique ultime, la mort, mais bel et bien en s’appuyant sur la raison et les sciences, et donc par extension sur la préservation de la vie. La place de l’individu et de son corps va plus tard faire l’objet de ce que l’on appellera la phrénologie, initiée par le physiologiste Joseph Gall en 1810. Selon cette théorie, les formes du crâne révéleraient la personnalité des individus observés (penchant pour le mariage, pour le meurtre, profondeur d’esprit…). Cette « science » totalement invalidée par la suite annonce l’anthropométrie, ou plus simplement la mesure des dimensions corporelles des individus (bras, jambes, poids…), à des fins politiques. Les criminels auraient certains traits physiques communs. Couplée aux statistiques, l’anthropométrie permettrait d’établir un profil type qui servirait de modèle à l’analyse de ces faits sociaux. Les mesures alors obtenues vont être conservées, le but étant de ficher tous les criminels et de faciliter leur identification en cas de récidive. Si ce dispositif est destiné au départ à un usage exclusivement judiciaire, très vite va germer l’idée de l’étendre aux masses. En 1885, au deuxième Congrès pénitentiaire international de Rome est évoquée l’instauration pour tous les habitants d’une « carte personnelle », dans laquelle est consignée leurs caractéristiques anatomiques. Pendant plus d’un siècle, les démocraties des pays industrialisés vont refuser d’y adhérer, par crainte d’atteinte à la vie privée. Pourtant, en France, entre 1913 et 1969, les étrangers et les migrants seront bel et bien soumis au carnet anthropométrique. Se cache alors derrière cette mesure les prémices d’une stigmatisation de l’ennemi qui menace l’équilibre social du territoire national : l’immigrant venu d’Europe.
Le contrôle des esprits : vers une guerre psychologique
La seconde partie de l’ouvrage va s’intéresser aux mesures prises par les États en temps de guerre. L’objectif est clair, gagner à tout prix, y compris en établissant un contrôle accru de sa propre population. Pour y parvenir, ces derniers vont exploiter le pouvoir du langage, déjà mis en lumière par l’écrivain Georges Orwell dans son roman « 1984 ». A travers le concept de novlangue, Orwell désigne le mécanisme d’appauvrissement du langage destiné à empêcher toutes tentatives de réflexion. Le langage est en effet l’instrument de la pensée, il permet de nommer les choses et d’élaborer des concepts. Dès lors, plus on diminue le nombre de mots et les structures grammaticales complexes et plus on restreint le domaine de la pensée, la finesse et les nuances du langage étant supprimées. Il en résulte des individus qui ne raisonnent que par l’affect, ce qui les rend plus vulnérables et malléables. Un camp des « méchants » et un camp des « gentils » vont très vite se dessiner sous leurs yeux, et toute critique ou idée subversive à l’encontre de l’État devient tout simplement impossible.
L’instauration et la diffusion d’une pensée unique institutionnalisée n’est possible que si elle est relayée, par les médias notamment. Cette idée sera largement répandue durant la Guerre Froide. Si cette dernière est avant tout une lutte idéologique, elle est aussi et surtout une « guerre psychologique », définie par « l’usage planifié par une nation en temps de guerre ou d’urgence déclarée de mesures de propagande destinées à influencer l’opinion, les émotions, les attitudes et le comportement des groupes étrangers, ennemis, neutres, ou amis en vue d’obtenir leur appui pour la réalisation de ses politiques et projets nationaux [ii] ». A l’instar des missions assignées aux agences de renseignement, cette guerre psychologique est à usage externe, c’est-à-dire qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer au territoire national. Pourtant, dans les faits, les journaux américains vont relayer les informations fabriquées par le gouvernement et les services secrets, illustrant par-là la porosité entre propagande et information. Alors que des régimes dictatoriaux tels que ceux de la Corée du Sud, de l’Indonésie ou du Guatemala étaient qualifiés de « régimes autoritaires », seuls les gouvernements supposés manipulés par le communisme international étaient labellisés comme étant des « dictatures ». Aux yeux des États-Unis, tuer des civils n’étaient donc pas le crime le plus abject : c’est tuer des civils au nom du communisme qui suscitait l’indignation. A ce sujet, le discours du Président Nixon en 1980, chantant les louanges de la dictature chilienne, symbole d’un capitalisme prospérant, est particulièrement représentatif : « […] la junte au pouvoir s’est embarquée dans ce que l’on a appelé un pari audacieux pour faire du pays un laboratoire pour l’économie du libre-échange. Les investissements sont montés en flèche, les impôts ont été réduits, la réforme fiscale promulguée. Les détracteurs se braquent uniquement sur la répression politique au Chili, en ignorant les libertés qui sont le fruit d’une économie libre ».
Noyés dans les paradoxes, les États-Unis vont peu à peu établir une véritable censure et des répressions au sein de leur territoire, dont le point culminant est la période du Maccarthysme entre 1950 et 1954. L’ambition affichée du sénateur a été de purifier le territoire des éléments communistes à travers une série de lois, parachevée par le Communist Control Act qui interdit le parti, au motif qu’il essaie d’établir une « dictature communiste totalitaire dans le monde ». Mais en cherchant à contrôler ses citoyens et en interdisant l’opposition, les États-Unis peuvent-ils encore prétendre être une démocratie ? Les révélations faites par la Commission Frank Church en 1976 semblent faire pencher la réponse vers l’existence d’une oligarchie dissimulée. En enquêtant notamment sur les activités de la CIA, il est apparu des violations de l’État de Droit commises au nom « de la sécurité nationale » ou de la « confidentialité requise par le caractère sensible des négociations ou opérations en cours ». Ces décisions, fondées sur des informations obtenues par des moyens clandestins et prises en secret par la seule branche exécutive, ont dès lors été soustraites à l’examen du peuple américain et du Congrès. Surtout, le rapport met en lumière le fait que les agences de renseignement ont appliqué des « techniques d’intrusion délibérée à des individus et des organisations qui ne mettaient en aucun cas la sécurité nationale en danger », à l’image de l’opération Minaret de mise sur écoute, entre 1967 et 1973, de 6000 étrangers et de 2000 organisations ou particuliers américains, dont Martin Luther King ou Jane Fonda.
Un contrôle à échelle planétaire : la crise de la démocratie
La troisième partie de l’ouvrage s’ouvre sur les crises économiques et politiques des années 70 qui interrogent sur une possible crise de nos démocraties. Certains auteurs l’expliquent par sa nature intrinsèque et la place prépondérante qu’y occupent les médias. La démocratie provoquerait d’elle-même un effondrement des moyens traditionnels de contrôle social et une délégitimation des autorités. Ce raisonnement conduit à la conclusion qu’il serait souhaitable d’y instaurer une limite en acceptant des dispositifs de contrôle et de surveillance afin de restaurer l’autorité.
En France, Valéry Giscard d’Estaing esquisse une ébauche de solution à cette crise : aller vers une « société de l’information ». A cette période, on insère dans la législation française les concepts de sûreté intérieure, d’État d’exception et de danger pour “l’intégrité des structures nationales”. En 1976, une série de projets de loi dits de « sécurité et liberté » voient le jour. La morosité économique fait place au bouc émissaire tout trouvé : la criminalité, entraînant un renforcement des mesures sécuritaires.
Dans le reste du monde, c’est l’instauration de nouveaux régimes d’urgence. En Allemagne sévit la Fraction armée rouge, l’Italie est confrontée aux brigades rouges et le Royaume-Uni à l’IRA. Ces nombreux groupes extrémistes prônent les attentats comme mode d’action politique. Ainsi, la notion de terrorisme se popularise mais on se retrouve face à un paradoxe : ce terme n’a pas de définition juridique exacte [iii] et plusieurs définitions peuvent cohabiter sur un même territoire comme c’est le cas aux États-Unis. L’auteur pointe du doigt les dangers d’une notion extensible qui est selon lui toujours source d’insécurité juridique. Cette série d’événements violents entraîne un recul des garanties procédurales (droit de la défense, détention préventive, dégradation des conditions carcérales). On peut citer par exemple en Allemagne la substitution de la présomption de culpabilité à la présomption d’innocence ou la légalisation de la mise à pied pour des raisons politiques.
L’implosion des régimes communistes pose pour les États-Unis la question de la préservation de leur statut d’unique superpuissance. Elle investit dans la collecte d’informations et met de nombreux moyens dans le développement d’une cyberwar, une guerre dite « propre » : sans mort, ni blessé. Cependant, les attentats du 11 septembre révèlent de nouvelles failles et le pays se doit de réagir avec des mesures fortes. Après 2001, le Congrès concède plus de liberté à l’exécutif. Se développe une doctrine de surveillance de toute la population afin d’intervenir en temps réel. Cette doctrine est scellée par l’instauration du Patriot Act dès novembre 2001. Cette mesure phare autorise sans informer les utilisateurs les mises sur écoutes, les perquisitions, les saisies d’ordinateurs, la traque des profils des lecteurs dans les bibliothèques… Alors qu’elle devait prendre fin en 2005, elle n’a cessé d’être prolongée par le Congrès et ce jusqu’en 2015, ce qui interroge le caractère supposément « transitoire » de ce type de mesures.
L’Union Européenne, quant à elle, n’envisage pas sa lutte contre le terrorisme dans une perspective militaire mais plutôt policière, ce qui encourage fortement une coopération interétatique. Avec la mise en place de Schengen, il devient nécessaire d’améliorer la coopération judiciaire. Ainsi, on voit naître une myriade de nouvelles entités de coopération et de partage de données comme le SIS (Système d’information Schengen), Europol (pendant européen d’Interpol), le CEPOL (Collège européen de police) ou Frontex. La complexification croissante des technologies de surveillance (vidéo-surveillance, décryptage des messageries électroniques…) conduit le secteur privé à entrer en jeu que ce soit aux États-Unis avec la Silicon Valley ou en Europe avec des géants de la sécurité comme EADS ou Thales. Ce partenariat conduit à une connivence avec le secteur public que déplore l’auteur et qui se traduit par des autorisations de fusions d’entreprises devenues régulières, dans les télécoms, l’industrie d’armement et la sécurité.
Aujourd’hui, c’est le secteur privé, seul cette fois, qui s’empare de ces nouveaux moyens de surveillance et de prévision des comportements à des fins commerciales. Face à ce constat, Armand Mattelart en appelle à une prise de conscience sociétale et à une intervention des pouvoirs publics qui va dans le sens d’une plus grande régulation des dispositifs sécuritaires et de collectes d’informations.
A l’issue de cette lecture,
Impossible de ne pas souligner l’extraordinaire sagacité et clairvoyance d’Armand Mattelard : 10 ans après, les questions qu’il souligne se posent avec plus d’acuité encore devant une ingérence étatique dans la vie des citoyens de plus en plus présente. De surcroît, l’intervention d’entreprises privées dans ces dispositifs de surveillance, à l’image de Cambridge Analytica, dont la collecte de données de 87 millions d’utilisateurs de Facebook a été utilisée pour la campagne de Donald Trump, renforce la suspicion des citoyens, qui sont dès lors piégés entre la surveillance étatique et la surveillance numérique.
Alexis Da Silva
i Ces définitions proviennent du Larousse en ligne.
ii Concept apparu pour la première fois dans le dictionnaire de l’armée nord-américaine en 1951
iii Dubuisson, François. « La définition du « terrorisme » : débats, enjeux et fonctions dans le discours juridique », Confluences Méditerranée, vol. 102, no. 3, 2017
